 Ne vous méprenez pas: on sait à quoi s'attendre en entrant dans la salle, et le cinéma de Michael Bay n'est plus à critiquer, il faut s'y abandonner car toute résistance est inutile. On parlait déjà de Transformers 2 à l'époque, et de ses curieuses mais néanmoins évidentes qualités, il est maintenant temps de clôturer le cycle le plus aberrant du début des années 2000 avec toute la candeur dont est capable le plus américain des cinéastes en activité aujourd'hui.
Ne vous méprenez pas: on sait à quoi s'attendre en entrant dans la salle, et le cinéma de Michael Bay n'est plus à critiquer, il faut s'y abandonner car toute résistance est inutile. On parlait déjà de Transformers 2 à l'époque, et de ses curieuses mais néanmoins évidentes qualités, il est maintenant temps de clôturer le cycle le plus aberrant du début des années 2000 avec toute la candeur dont est capable le plus américain des cinéastes en activité aujourd'hui.Il faut se rendre compte de l'industrialisation de la production qui permet à Michael Bay, Dreamworks et ILM de sortir un Transformers tous les deux ans, avec une précision glaçante, symptomatique d'Hollywood et de sa production passe-partout. Le travail est énorme et les enjeux artistiques (autres que visuelles) deviennent proches du néant à mesure que les films s'empilent.
Au final, lorsque Michael Bay ne redéfinit pas le film d'action pyrotechnique, il a tout le loisir de se consacrer à ses voitures et ses mannequins de lingerie, placés sur un même pied d'égalité: Rosie Huntington-Whiteley, qui remplace Megan Fox (belle promotion pour un premier film), est une top-modèle estampillée Victoria's Secret que le réalisateur a déjà mis plusieurs fois en scène dans des clips pour la marque. Le garçon comme les autres qu'était Shia LaBeouf dans les précédents films, se demandant ce qu'il allait faire pour garder sa petite amie, n'est plus: ici, il possède, sans enjeux véritables, une petite amie trop belle - selon les standards californiens s'entend - pour être vraie.
Complètement désincarnée, celle-ci tente vainement de participer à la narration mais ne nous fera vraiment que les honneurs d'un plan subliminal à la Basic Instinct en sortant d'une voiture.
Légèrement moins puéril, le film est toujours hystérique et ne sait parfois plus se contrôler. John Torturro rejoue la même partition, et même Shia LaBeouf s'y met, remplaçant parfois ses lignes de dialogues par des hurlements ne servant pas vraiment la progression de l'intrigue. Les nouvelles recrues, Alan Tudyk, Frances McDormand et John Malkovich (pas moins), n'apportent rien à l'ensemble si ce n'est le trait de comédie gratuit et débilitant, embrayant la machine vers des sommets de non-sens.
Pour autant, moins empêtré dans des sous-intrigues abyssales à la manière du deuxième volet, le film file droit et s'applique à retrouver le chemin traditionnel du blockbuster américain: envers et contre tous (et surtout en dépit du bon sens), sauver le monde et sauver la fille. Ce qui en soi chez Michael Bay impose un parcours du combattant pour arriver à bon port, et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au bonhomme, c'est bien sa générosité toute perverse.
 |
| Eye-candy of the day |
Et même si le petit garçon du siège d'à côté et votre serviteur tentent de déterminer dans ce tonnerre mécanique qui est qui (Starscream, c'est celui qui vole), il en faudrait beaucoup plus pour qu'on s'émeuve du destin digital de ces créatures fantasmées.
 |
| Lot de consolation : des plans fous de Chicago assiégée |
Les contraintes de la 3D ont obligé Michael Bay à assagir sa mise en scène ; considérablement calmé sur le montage frénétique de plans épileptiques, le bonhomme pond enfin des séquences lisibles, avec toujours la même ferveur pour la destruction massive. La séquence d'autoroute répond bien présente, avec des fulgurances de violence métallique qui n'auront d'écho qu'au sein du même film, une heure plus tard, dans une conclusion à rallonge au sein d'un Chicago dévasté. Les séquences sont plus incroyables les unes que les autres: couchage d'immeuble, sauts hallucinants en combinaisons de vols, pugilats exploitant tout l'environnement et chute des corps humains d'une violence inouïe. Pourtant, une certaine monotonie s'empare du spectateur, habitué depuis trois films et pour qui la course à l'épate devient de plus en plus inconséquente.
Le siège de la ville aurait pu être hallucinant s'il ne durait pas aussi longtemps ; on ne parle même plus de fantôme du 11 septembre derrière ces destructions d'immeubles, mais bien de reformatage inconscient du film d'action total où s'agglomèrent tellement d'éléments qu'en sortant de la séance, on ne sait plus ce qu'on a vu. La séquence de la chute de l'immeuble coupé en deux, si elle reste lisible, originale et bien foutue malgré l'aberration évidente de la chose, est l'exemple typique du cinéma de Michael Bay, ravi de ses idées foutraques et complètement gratuites.

Constat dramatique à mesure que le film s'égrène : le montage, les ralentis, l'hyper-rythme forcé ne suffisent plus. Les vertiges et points de vues disparaissent. Rapidement, on entreverra un exemple parfait d'homme dans la machine, à peine le temps de l'évoquer que l'idée aura disparu derrière les plans de courses. Les vertiges en IMAX de The Dark Knight ne trouvent aucuns écho dans ce Transformers 3, pourtant parti pour être un joli crû qui peine à garder sa hauteur d'homme et à contrôler ses ambitions pour être vraiment satisfaisant.
Les quelques idées susceptibles de faire poindre l'émotion et d'apporter de la grandeur à l'entreprise (l'introduction, la mort des personnages, le destin de Sam) sont annihilés dès que l'idée est amorcée et ne subsiste que la narration, pressée autant que possible. Pourtant l'amorce de la chose donnait du corps à l'entreprise en suggérant que la course aux étoiles des années 60 était motivée par un évènement extraterrestre sur la face cachée de la Lune (second révisionnisme estival avec la Crise des Missiles version X-Men First Class), revisitant l'histoire des États-Unis jusqu'à l'improbable caméo du real American hero, Buzz Aldrin lui-même.
Très logiquement, le film cherche l'annihilation totale avec son scénario de fin du monde, encore une fois tiré par les cheveux mais semblant concentrer l'essentiel des enjeux (pour ceux que ça intéresse encore) entre Autobots et Decepticons (tristesse des blagues foireuses, pauvreté des personnages secondaires, assimilations malheureuses des visages acteurs/robots). Bon courage pour les 2h30 de projection avec les lunettes 3D sur les yeux, la chose ne se faisant pas sans mal.
Avec Transformers 3, Michael Bay clôture son cycle mécanique fourbu, avec cette désagréable impression de vouloir tout fourrer, tout emboîter... pour passer à autre chose peut-être ? Non, ça serait trop en demander au plus grand apôtre de la déconstruction systématique du plan. Le bonhomme perd le capital sympathie qu'il avait su engranger précédemment (on se contrefout de tous les personnages) et n'offre véritablement rien auquel se raccrocher, même si on ne peut lui enlever une série de plans inouïs au cœur d'une Amérique qu'il n'aime jamais autant que quand elle est soumise à l'adversité la plus improbable.
- Pour les nostalgiques d'amour vrai et de blockbuster dégénéré parfait, on parlait d'Armageddon au cours d'une rétrospective émue consacrée à Liv Tyler ici-même. Pour les autres, il reste des "je t'aime" vides de sens, des mots parmi d'autres qu'on échange sur le champ de bataille, avant un hors-champ qu'on devine aplani et stérile.
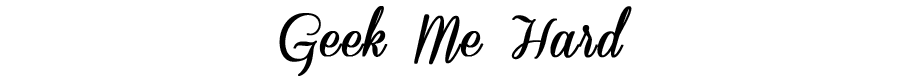

















0 commentaires:
Enregistrer un commentaire